
SOMMAIRE
I. Réponse aux accusations
1. L’esprit de l’inquisition. I.2. Manichéisme ? La paille et la poutre ; I.3. « Idéologie » ? Il s annulent l’histoire ; I.4. Contre l’esprit des sciences? L’hôpital qui se moque de la charité; I. 5. Accusation « sociale et politique » : la tartufferie inquisitoriale
II. Le puits sans fond de l’« écologie profonde » : démagogie animiste et réactionnaire
1. Fondements animistes de l’« écologie profonde » ; 2. Les errances de l’«écologie profonde à visage chrétien » et de la « théorie de l’intendance » ; II. 3. Simulacre d’humanisme des antihumanistes de l’« écologie profonde » ; 4 Colonialisme, esclavagisme… Gauchisme: la maladie infantile de l’écologie profonde ; 5 Croissance : les affabulations de l’écologie profonde ; 6. La fantasque santé de la planète et la lutte pour la vie des humains.
P
En cette période d’hiver de la pensée qui entraine tant de bons esprits vers l’idolâtrie de la planète, le pasteur Robin Sautter, Roger-Paul Bory et Vincent Wahl, qui se réfèrent à un réseau appelé « Bible et Création », ont cru utile d’ajouter leur touche aux frimas. Pour défendre l’« écologie profonde », et, chemin faisant une « église verte », ils ont publié, le 4 décembre 2020, sur le Forum de Regards Protestants, un texte virulent au titre qui laisse songeur pour qui connaît les thèses de ce courant : « Écologie : sortir du manichéisme » (voir plus bas, Annexe II). « Au vu de l’ensemble de la Bible » dont ils auraient le secret, ils y dénoncent mon « manichéisme », et, à travers moi celui des partisans du progrès, y compris écologistes opposés à leurs thèses. Un manichéisme qui se serait exprimé dans un petit texte paru sur mon blog de Regards Protestants sous le titre : « les différentes écoles de l’écologie (voir Annexe I).
Ce texte énonçait l’idée que « la vraie écologie est incarnée par le camp du progrès, seul apte à mettre l’humanité au cœur de sa pensée et à résoudre, notamment par les nouvelles technologies, les défis de la planète, pollutions comprises. » « Notamment » écrivais-je, et non pas « seulement « .
Il donnait, un aperçu rapide de certaines réponses scientifiques à quatre questions souvent soulevées par les partisans de l’« écologie profonde » : le CO2, l’énergie, la démographie et la santé. Il se référait explicitement à mes deux derniers ouvrages afin que chacun puisse discuter plus au fond de mes thèses, s’il le désirait. D’abord à « L’Homo creator face à une Planète impitoyable », qui raconte l’histoire de l’humanité durant 7 millions d’années avec les effets sacrificiels de l’animisme et de son idolâtrie de la nature. Ensuite, au livre « Le Bel Avenir de l’Humanité », qui prouve, contre les visions apocalyptiques, comme celles d’un Yuval Noah Harari ou de l’ « écologie profonde », la merveilleuse révolution des Temps contemporains née de l’explosion des nouvelles technologies et de la libération de la créativité humaine, en particulier celle des femmes, avec son mouvement vers l’abolition progressive du travail aliénant, vers la fin des maladies génétiques, virales, bactériologiques, cancers… le nouveau rapport au donné génétique et à la mort, la nouvelle productivité infinie sans déchets née des nanotechnologies, une énergie inépuisable, l’extinction de l’ « État » et de l’idolâtrie des « pouvoirs»… et même un chapitre sur le « Nom de Dieu » en hommage à l’ami Umberto Eco dont j’aime croire que, s’il avait vu ma perception proche de celle de Max Planck et la recherche de paix héritée de Leibnitz, il l’aurait apprécié. Ce dernier livre, comme le savent les lecteurs du blog, publié avec deux ouvrages inédits de Raymond Aron et Hannah Arendt, ayant conduit à relancer la collection « Liberté de l’esprit » de Raymond Aron chez Calmann-Lévy.
Répondre aux trois accusateurs ? J’y fus prié par quelques amis scandalisés par le texte de ces trois étonnants signataires qui semblent avoir plus appris des procès de l’inquisition que d’une lecture pleine de tolérance et de compassion de la Bible. J’ai mis du temps à m’y résoudre. À vrai dire, en période ordinaire, je passerai mon chemin face à des gens qui m’attaquent personnellement, m’accusent en miroir, envers eux de mépris et d’« insulte », délit pénal, alors que je ne les connais pas, déforment systématiquement mes positions, dénoncent ma prétendue « idéologie », qu’ils sont bien incapables de désigner, prétendent même que je n’ai aucun souci du « social » comme s’ils en avaient le monopole. Va encore pour leurs fantasmagories gauchistes d’un effondrement prévisible d’une « civilisation occidentale » et « impérialiste » qui aurait produit, outre quelques effets positifs, colonialisme, esclavagisme, oppression et, qui, aujourd’hui, serait coupable de « brûler la planète ». Passe encore qu’ils se réclament du philosophe norvégien Arne Næss, inventeur de l’« écologie profonde », dont il dissimulent l’idolâtrie fondatrice, celle de la planète pour la vendre à une église qui devrait devenir « verte ».
Mais ils nous informent que s’ils m’incriminent, c’est « au vu de l’ensemble de la Bible », dont ils auraient eu la révélation, ce qui les autoriserait à considérer pour nuls certains textes de la Bible qui les gênent et à m’accuser de défendre « une domination despotique et même parfois tyrannique de l’humain sur la planète ». Soupçonné d’être un mécréant pour ignorer leur Bible vraie, version Arne Næss, je suis accusé de la plus dangereuse des idolâtries, celle qui croit en la « prééminence » de l’humanité. J’ignorerais que « la créature idolâtrée est bien plus souvent l’homme qui se proclame tout-puissant ». Selon eux, le « vrai humanisme » biblique ne célèbrerait pas l’humain, comme j’oserais, en hérétique, le prétendre , mais la vraie « créature » de Dieu, « qui peut être comprise comme la nature, Gaïa » dont l’humanité serait une partie, en « interdépendance » avec les autres sous-systèmes naturels.
Dans son Court Traité du Pouvoir Tyrannique, face à ses inquisiteurs qui l’accusaient « au vu de l’ensemble du contenu biblique », Guillaume d’Occam (1285-1347) notait déjà : « vous rejetez ceux qui veulent vous informer de la vérité, vous défigurez leurs arguments, et vous les condamnez », alors pourquoi débattre ?
Néanmoins, malgré les risques, il l’avait accepté en raison des enjeux : « je ne veux pas être ajouté au nombre de ceux qui craignent de parler librement parce qu’ils redoutent de perdre les bonnes grâces des hommes ».
Aujourd’hui, en raison de cette vague obscurantiste qui déferle sur certains pays occidentaux riches au nom de la « planète » jusque dans les églises chrétiennes, il n’est peut-être pas absurde de profiter de l’occasion pour tenter de percer un peu le brouillard idéologique diffusé par les apôtres de l’« écologie profonde » et de la « théologie de l’intendance ».
Sans nier leurs bonnes intentions, celles dont l’enfer est peuplé, force est de constater qu’ils désespèrent la jeunesse, détournent les énergies du progrès, freinent la créativité nécessaire contre la détresse, diffusent tristesse et nostalgie au lieu de la joie et de l’espérance, et cela pour diffuser un panthéisme animiste contre lequel judaïsme, christianisme et islam se sont dressés dès leurs naissance. Et contre lequel, un rationalisme, même tempéré, ne peut acquiescer.
Bien incapable de ce « vu d’ensemble de la Bible » de mes détracteurs, on me pardonnera de tenter de ramener au bon sens et, en chemin d’envisager une interprétation singulière, et sans doute critiquable, de quelques textes bibliques qui concernent les points soulevés.
Une façon d’affirmer, en sujet éthique tâtonnant et conscient des abîmes d’ignorance qui m’habitent, mais déterminé à refuser les idolâtries, un droit d’interprétation qui se passe de Maîtres de Vérité, grands et petits. J’essaierai de défendre cette idée du camp du progrès depuis la Renaissance, que l’humanité est au centre de la création, en position « prééminente », infiniment supérieure aux autres vivants, irréductible à une prétendue « interdépendance » avec végétaux et animaux, apte à devenir « temple de Dieu », à recevoir grâce et sacrements, à prier et célébrer un créateur qui l’a fait à son image. Avec le droit de créer pour dominer la nature et d’assujettir ce qui s’y trouve, le devoir d’aimer son prochain (humain), fut-il étranger, comme lui-même… et même de recevoir une bonne nouvelle en attendant une résurrection individuelle éternelle, totalement indépendante de cette planète condamnée, elle, avec ses mottes de terre, un jour, à disparaître.
Dès le début, les trois auteurs annoncent qu’ils ne répondront pas « point par point » à une prétendue « instrumentalisation des données scientifiques ». En effet, ils ne répondent ni « point par point », ni, d’ailleurs, à aucun point. C’est une des caractéristiques de ce courant, tactique éculée de l’inquisition : attaquer le bonhomme plutôt que répondre à ses thèses.
Au lieu d’argumenter sur les faits, ils préfèrent donc l’attaque personnelle. À les en croire : « il est difficile de réagir à un article où l’auteur manie, avec dextérité, le pamphlet, la stigmatisation et le mépris de tous ceux qui ne partagent pas sa propre idéologie sans tomber soi-même dans le piège d’une spirale de l’insulte ! » Diantre ! ma voilà coupable d’insulte, de stigmatisation et de mépris pour avoir osé ne pas partager leurs thèses
Le sens du mot « insulte » est sans équivoque : il est l’expression d’une volonté d’outrager personnellement. C’est une forme d’injure sanctionnée par le code pénal. Il signifie le viol des bonnes mœurs et la volonté de dégradation humaine envers un individu désigné par des mots.
Or, je n’insulte aucune personne dans l’article incriminé et certainement pas ces trois inquisiteurs dont je ne connaissais pas même l’existence. À l’inverse, je critique l’« écologie profonde », sa démagogie, son obscurantisme, sa misère théorique et ses propagandistes dont je ne préjuge aucunement qu’ils seraient, en plus, opposés aux bonnes mœurs. Car je ne mélange pas le débat d’idées et les jugements moraux sur les personnes qui portent ces idées.
M’accuser de les insulter, c’est-à-dire de violer les bonnes mœurs et d’avoir la volonté de dégradation humaine envers eux, et cela alors que je ne les connais, ne les cite pas, n’insulte personne ? Il s’agit donc d’une diffamation.
Qu’ils m’accusent encore de stigmatiser et de mépriser le monde entier, sauf les partisans de mes thèses, alors que la simple lecture de ce texte, comme de mes livres, démontre que je défends tous les courants du progrès, en particulier tous les courants écologistes, mais non le leur, confirme que dès la première ligne, ils engagent la spirale de l’attaque personnelle qui se justifie à leurs yeux par mon opposition à leurs idées, comme pour toute inquisition qui préfère au débat, l’accusation d’immoralité.
Ils ne veulent pas distinguer les thèses d’un auteur, qui peut être critiqué comme auteur, et sa vie privée comme personne. Une confusion volontaire des thèses des opposants et de leur moralité qui se retrouve systématiquement dans toutes les inquisitions, jusqu’aux procès de Prague.
Avouer qu’il leur avoir été « difficile » d’éviter la « spirale de l’insulte », révèle non leur grande vertu mais leur fourberie, leur volonté de « salir » l’image leurs opposants pour imposer leur condamnation.
Pour ma part, je pense que les idéologies aveuglent et que bien de bons esprits sont par elles détournées de la quête de la vérité et de l’amour dû au procain.
Ces inquisiteurs m’accusent d’être « manichéen » et de condamner « tous ceux qui ne partagent pas (ma) propre idéologie ». Accusation cocasse venant de partisans de cette « écologie profonde » née (nous y reviendrons) du rejet radical de tous les courants de pensée qui défendent croissance et progrès, et des courants écologistes appelés avec mépris « écologie superficielle » par Arne Næss. « On voit la paille dans l’œil du voisin mais pas la poutre dans le sien »…
Le titre de mon article était pourtant clair : « Les différentes écoles de l’écologie ». Et non : « les deux écoles de l’écologie ». Le contenu aussi : j’y défends le camp du progrès, et ses nombreuses écoles, contre le camp obscurantiste de l’« écologie profonde ».
Serait-il donc « manichéen » de tenir pour fausse l’ « écologie profonde » ? À les en croire, il faudrait être plus subtile et prendre en compte les différences entre leurs sectes, plus ou moins rouges, plus ou moins vertes, toutes idolâtres. Or, si je ne suis pas favorable d’aimer « à la folie » l’idole Gaïa-la-Planète, je ne le suis pas non plus de l’aimer « beaucoup », ni même « un peu ». Mais « pas du tout ». Car la planète n’est pas un vivant. Pas même un être.
Contre les gris-gris de l’imagination et contre l’animisme, la conscience qu’il existe un amas appelé « terre » ne prouve ni la vie, ni, encore moins, la conscience de cette planète. Pas plus que la conscience qu’il y a des mottes de terre, ne prouve leur conscience. Et pour comprendre ce qui s’y joue, Planck et Einstein ont plus d’utilité que l’astrologie et l’animisme.
Nos inquisiteurs m’accusent, ainsi que tous ceux qui ne communient pas avec eux, de défendre une « idéologie ». Laquelle ? Ils n’en disent mot. Diaboliser est au cœur du tous les procès engagés par les écologistes profonds pour terroriser leurs adversaires et les faire taire. Le lecteur doit comprendre que puisque je refuse la leur, c’est que j’en défends une autre. Un truc largement utilisé par toutes les inquisitions. Les partisans des droits de l’homme dans les pays staliniens, étaient nécessairement des défenseurs du « capitalisme » et les théologiens comme Maître Eckhart ou Guillaume d’Occam des « hérétiques » défenseurs d’une religion opposée à la bonne…
Une idéologie est un système fermé et global d’idées, de valeurs, de comportements qui veut s’imposer sur la société au nom d’un idéal social et politique, au mépris des faits et du respect des droits individuels. Dans mes écrits, non seulement je n’en défends aucune mais que je les combats toutes. Comme dans mes cours d’épistémologie, j’y défends les « sociétés ouvertes » (Karl Popper), les « programmes de recherche scientifiques » (Imre Lakatos) qui avancent par essais-erreurs et une métaphysique qui place les individus, leur libre créativité et leur capacité de décider du bien et du mal, au centre.
À l’inverse, les partisans de l’« écologie profonde » sont des idéologues.
Ils falsifient les faits jusqu’à inventer une planète fictive avec laquelle l’humanité aurait été en harmonie. Harmonie qu’ils prétendent retrouver par des actions de contrôle sur le mode de production, les sciences et la vie quotidienne des citoyens. Leur idéologie est ainsi totalitaire. Cela au nom de la « planète » à « sauver», dont ils connaitraient les besoins en nouveaux Maîtres de vérité.
Contre cette idéologie : l’histoire. Dont j’ai rappelé quelques faits dans l’article incriminé et, développée en détails dans L’Homo creator face à une Planète Impitoyable.
Quand commence le paléolithique, il y a environ 3,5 millions d’années, nos ancêtres ont déjà traversé 4 millions d’années d’holocaustes dus à la planète. Combien sont en vie ? 100 000 seulement après 4 millions d’années ! La fameuse Gaïa a détruit tous les autres. Après le paléolithique, encore des holocaustes et non une vie harmonieuse avec la nature. Des glaciations en nombre, 17 lors des seuls 2,6 derniers millions d’années, et autant de réchauffements inconnus de nos idolâtres qui veulent, pour culpabiliser l’humanité, tout ignorer des explosions nucléaires du soleil, des variations de l’angle de l’orbite et de l’axe de rotation terrestre, des déséquilibres « naturels » de l’atmosphère elle-même. Tout ignorer aussi des éruptions volcaniques, secousses sismiques, tempêtes, cyclones, tornades, tsunamis… des virus et bactéries, tout aussi naturels, vieux de plusieurs dizaines de millions d’années pour la coqueluche, la tuberculose, la lèpre, la syphilis… des cancers de toutes sortes, des os au cerveau… des maladies génétiques, des attaques animales… Que reste-t-il quand débute le néolithique, il y a 12 000 ans, des espèces humaines du genre Paranthropes et Homo qui survivaient encore au paléolithique ? « Les Paranthropes ? Des trois espèces, il ne reste bientôt plus rien, détruits à leur tour. Des 22 espèces du genre Homo ? Une seule a survécu. Oui, une seule. La fameuse Gaïa-la-Terre bienveillante a éliminé les 21 autres de la carte planétaire » ( L’Homo creator face à une Planète impitoyable). Finalement, 500 000 humains seulement sont parvenus au néolithique. Un gain de 400 000 individus en 3,5 millions d’années ! Et seuls 12% peuvent espérer dépasser 40 ans.
Voilà les faits.
Les idéologues de l’ « écologie profonde » doivent nier l’histoire et prétendre que les maux venus de la nature, des virus aux cyclones, sont dus à l’humanité, tant ils craignent de voir que les humains en concluent judicieusement que la planète ne mérite aucune génuflexion, brisent l’autel de Gaïa et se gaussent des nouveaux petits Maîtres de Vérité.
Pour vendre leurs dogmes, les idéologues de l’ « écologie profonde » n’hésitent pas à attribuer à leurs opposants des positions si ridicules sur les sciences que Bouvard et Pécuchet eux-mêmes ne pourraient y adhérer. Ils prétendent que je refuserais de discuter de la « pertinence des innovations technologiques » dont je défendrais les bienfaits aveuglément. Où ai-je écrit qu’il était interdit de discuter des innovations technologiques ? Nulle part. Dans le petit article incriminé, je réponds seulement par des faits scientifiques à quelles unes des affabulations de l’écologie profonde.
Eux, à l’inverse, seraient ouverts, tolérants, mais méfiants. Pour justifier cette méfiance, dont on va voir qu’elle est conduit systématiquement à mettre en cause les avancées technologiques, ils avancent cette banalité connue depuis plus de deux mille ans, qu’ils prennent pour une découverte exceptionnelle de l’« écologie profonde » : les sciences se trompent parfois et connaissent même des impasses. Ce qui leur permet de se livrer à une attaque en règle contre l’esprit des sciences et ceux qui le soutiennent.
Ils ont raison : les positions du camp du progrès et les leurs sont incompatibles.
Car loin de nier les impasses et les erreurs scientifiques, et loin d’en profiter pour vouloir freiner les sciences les contrôler avec des administrations ou des comités d’experts en Bible verte, les amis du progrès les célèbrent. Et cela depuis Aristote et Archimède.
Car toute l’histoire du progrès est en effet une avancée par essais et erreurs. Et cela ne se peut autrement. C’est pourquoi il est si important pour toute proposition authentiquement scientifique d’être falsifiable par les faits, que la concurrence scientifique soit assurée et que soit libérée l’innovation créatrice en lui donnant par la croissance les moyens d’avancer toujours plus loin. C’est aussi pourquoi il est important aussi d’offrir aux individus le maximum de culture possible pour qu’ils participent à la créativité et aux débats rationnels et résistent ainsi à l’obscurantisme des démagogues qui leur vendent vents apocalyptiques, éoliennes idéologiques, contrôle étatique de la vie quotidienne en guise de pensées.
À l’inverse, les idéologues de l’« écologie profonde « profitent de la moindre erreur, de la moindre faille, de la moindre imperfection pour pointer du doigt les innovations, attiser les peurs, freiner la créativité et vendre l’apocalypse selon saint Profond. Au nom de la « précaution » et de la « prévention », ils combattent l’esprit d’innovation.
Or, puisqu’il y a toujours des imperfections, des points d’ignorance, des incapacités à prévoir les conséquences des innovations, puisque tout ce que l’humanité peut faire c’est « le meilleur possible » (Aristote) et non le meilleur, les occasions sont innombrables pour qu’ils puissent vendre effrontément, effondrement de la civilisation, terre qui brûle, Planète qui meurt … Ils auraient interdit l’usage du feu, généralisé il y a 400 000 ans au nom des incendies possibles de forêt et la taille du silex au nom du danger de fabriquer des pointes de flèche comme nos trois compères dénoncent aujourd’hui la « course » aux nouvelles technologies.
Face aux erreurs et impasses, le camp du progrès dénonce la misologie (haine de la raison) comme la pire des solutions. Il affirme que nous ne souffrons pas de trop de savoir et de technologies mais de pas assez. Non pas de trop d’individualisme créatif mais de pas assez. Et, j’ose même m’aventurer à défendre, comme un célèbre théologien, que les avancées du savoir sont un peu comme des grâces, des dons de l’Esprit de Dieu, distribués « pour le bien commun du genre humain »…
« Les questions sociale et politique sont entièrement absentes du discours de M. Roucaute, sinon pour fustiger les rouges-verts au détour d’un paragraphe » accusent mes inquisiteurs. « Entièrement absentes » ? Me voilà sans cœur « social » et sans conscience « politique » mais non sans reproches. Les écologistes profonds auraient-ils donc le monopole du cœur ?
Qu’ils associent « social et politique » est symptomatique. Ces défenseurs de l’« écologie profonde »prétendent régler les « problèmes sociaux » par des réglementations « politiques » : punitions, chasse aux riches, aux savants politiquement incorrects, aux philosophes qui défendent la liberté… jusqu’au droit à l’inquisition dans la vie privée des citoyens, assiettes comprises.
Le camp du progrès refuse cette association du « social » et du « politique », typique de l’héritage marxiste. Il croit en l’individu charitable, aux associations dont les églises, les syndicats, les groupes de solidarité interindividuel, il croit au jeu mutuelliste et à plein de trucs qui mettent individu, famille, société civile au centre et excluent la prééminence de l’État
Je soutiens avec John Locke, que tout ce qui est social n’est pas politique, que le politique est second, créé par et pour les individus, et que l’appétence pour le « pouvoir » est concomitante de la tendance à en abuser. Les décisions de certains maires écologistes profonds en France démontrent, s’il le fallait, cette propension d’enfermer les libertés sous prétexte de « sauver la planète » dés que certains ont une once de « pouvoir ».
A vrai dire, le politique est un mal. Un mal nécessaire contre un plus grand mal. Dans les trous des mailles du filet social, quand le libre jeu interindividuel et inter-associatif ne suffit pas, alors les interventions politiques peuvent être utiles pour arrêter le crime, aider les plus défavorisés, veiller à l’égalité des chances, permettre d’exercer la créativité individuelle de chacun en supprimant les obstacles… Le champ d’action peut être plus large dans les situations de crises ou les moments de résistance à l’oppression étrangère.
Mais les détenteurs du « pouvoir » politique doivent voir leur activité limitée, contrôlée, réduite quand cela se peut. Derrière l’étatisme de l’écologie profonde, comme hier derrière l’air de la sociale des totalitarismes rouges, bruns et verts, j’entends toujours les grognements du Léviathan.
À l’inverse, le camp du progrès a bien le souci du « social ». Du vrai « social ». Car défendre les innovations technologiques, la mondialisation, la croissance et la créativité pour une domination toujours plus grande de la nature est l’expression d’un point de vue « social ». Et c’est bien ce que le petit texte mis à l’index par nos inquisiteurs a dit.
Non pas l’ »oubli » du social, mais sa prise en compte authentique. Et «authentique » n’est pas un mot anodin.
Oui, il est « social » d’éradiquer au bénéfice de ceux qui en souffrent, les maladies virales naturelles, les maladies bactériennes naturelles, la maladies parasitaires naturelles, les maladies génétiques naturelles… de prévoir les moyens de résister pour les villages et les villes aux éruptions volcaniques naturelles, aux tsunamis naturels, aux cyclones naturels, aux tornades naturelles, aux tremblements de terre naturels… d’abolir la mortalité infantile qui touche surtout les plus défavorisés, d’augmenter l’espérance de vie pour tous… de préparer l’abolition du travail qui conduit à l’aliénation et à la souffrance, de façonner des aliments améliorés et faible prix voire gratuits, de produire de l’eau jusqu’au Sahel, de partager savoirs et technologies avec les pays les plus déshérités…
Des problèmes sociaux ? Il y en a, et il y en aura longtemps. L’humain n’est ni un dieu, ni un demi-dieu. Mais l’humanité n’a pas besoin des idéologues de l’« écologie profonde », de ses militants et chefs ignorants. Elle a déjà payé lourdement dans le passé sa croyance en des Maîtres de vérité qui profitent de la souffrance pour vendre recettes de bonheur et mesures liberticides. Et qui freinent la course à la créativité et à la croissance, donc la course vers toujours moins de souffrance et plus de justice sociale. C’est pourquoi, il est vrai de dire que non seulement l’écologie profonde n’a pas le monopole du cœur mais qu’elle en est son fossoyeur.

Contre le camp du progrès, les partisans de l’« écologie profonde » prétendent qu’ils échapperaient à l’idolâtrie, surtout quand il se trouvent dans des environnements influencés par les religions du Livre. Que mes trois accusateurs se réclament du philosophe norvégien Arne Næss pour un tel déni est étonnant.
Certes, Arne Næss, à partir de son article de 1973 publié par la revue Inquiry, est le fondateur de cette idéologie qu’il définit comme « écologie profonde » (« deep ecology »). Cela en opposition avec ceux qui croient au progrès scientifique et technique, au productivisme, à la croissance et qui mettent l’humain au centre de leur projet (« anthropocentrie ») mais aussi aux autres courants écologiques, condamnés sous l’étiquette d’ « écologie superficielle » (« shallow ecology »). Elle nierait en effet l’urgence de sauver la planète menacée d’une « éco-catastrophe » par des déséquilibres grandissants, des pollutions innombrables et un épuisement des ressources dus à l’humanité. Elle est accusée d’une sorte de collaboration avec l’ennemi en voulant « protéger la nature » au lieu de la sauver. Par la diminution des effets négatifs du mode de vie capitaliste et consumériste, elle lui permettrait de survivre et même de développer un business vert. Elle reproduirait la « prééminence » de l’humain, faute de s’attaquer aux fondements « anthropocentriques » de la destruction de la planète. Finalement, elle peindrait en vert les illusions appelées « développement », « croissance », « consommation ». Au passage, on s’amuse de l’accusation de « manichéisme » de trois inquisiteurs….
Arne Næss exige de changer radicalement de point de vue, d’appréhender le monde « profondément ». Au lieu de partir de l’humanité, il faudrait adopter celui de la planète, du « Grand Soi », sorte de super-organisme que l’un des théoriciens de l’« écologie profonde », James Lovelock, appelle « Gaïa ». Il engloberait tous les sous-systèmes, en particulier le petit « soi », le « soi » humain.
En conséquence, comme il le dit dans Écologie, communauté et style de vie, moralement le sous-système humain, ne vaut pas plus que les écosystèmes animaux, végétaux et minéraux. Il est un sous-système de la nature non pas « disjoint » de la planète mais « relié » à elle. Toutes les « formes de vie » se valent et sont à protéger. C’est l’« égalitarisme biosphérique ». Une vision que je crois aux antipodes du christianisme.
Cette « approche morale » conduit à « s’indigner » devant les violences faites à la planète et à éprouver en soi le « sentiment » qu’elle éprouve face à l’action destructrice des humains. Tout comme ces enfants qui tuent des moucherons avec un spray, voyant leur souffrance, parviendraient à cette conclusion que « ces animaux, comme vous, préfèrent probablement vivre que mourir ». Arne Næss donne aussi l’exemple des propriétaires de chiens qui découvrent que « le bien-être de leur animal est plus important que celui de leur voisin ».
Tout étant lié, les attaques de l’humain contre le Grand Soi provoqueraient logiquement, en retour, des réponses négatives des autres sous-systèmes et de la planète tout entière. Ce qui expliquerait le malheur humain. Si la terre brûle et menace la vie humaine, s’il y a des virus et de la souffrance humaine, la cause en serait ces comportements antinaturels.
Mais, grâce au parti de l’« écologie profonde », le salut serait possible. En changeant de point de vue, l’humanité retrouverait le chemin de l’harmonie, de la « symbiose » avec la nature, un « style de vie » dit Arne Næss qui conduira le « soi humain » à communier avec le « Grand Soi ». C’est ce qu’il appelle « la Réalisation de Soi » qui n’a rien de la réalisation de « soi » : la majuscule du « Soi » indiquant que l’égocentrisme n’est plus de mise. Chacun doit avoir l’objectif moral d’« être la nature » par identification à son environnement, car le vrai « soi » est commun aux animaux et aux plantes et la voie de sa réalisation passe par l’identification avec « tous les êtres vivants »( Self Realisation).
Donc « les humains n’ont pas le droit de réduire cette richesse (de la nature) et cette diversité, sauf pour satisfaire des besoins vitaux ». Il faudrait s’engager vers « une baisse substantielle de la population humaine », 9 milliards d’individus étant le maximum, et du « niveau de vie » avec une décroissance des sociétés « riches ». D’où la défense d’une « éthique de la terre » théorisée par américain Aldo Leopold et reprise par quelques évêques américains en 1980 : « une chose est juste quand elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique ». Une éthique qui conçoit l’humain au même titre que « le sol, l’eau, les plantes et les animaux ou, collectivement, la terre » (Almanach d’un comté des sables). Une éthique qui proclame avec Arne Næss: « la nature compte sur vous » pour la sauver.
Cette « voie » aurait été préparée par le philosophe Spinoza, qui est l’un des seuls théoriciens à échapper aux foudres d’Arne Næss en raison de son panthéisme, mais aussi par le bouddhisme, le taoïsme et l’hindouisme de Gandhi, dont il dit qu’ils l’ont influencé pour rompre avec l’« anthropocentrisme » . Mais évidemment pas un seul théoricien chrétien. Elle conduirait à une « écosophie » au lieu d’une « philosophie ». Dans « philo », l’idée d’ « aimer »(φιλεῖν) placerait encore l’humain au centre. L’« écosophie » développe elle l’« écocentrisme » : le primat de l’écosystème et du « Grand Soi » sur l’humain.
Transformer la nature en être, vivant et supérieur, et réduire l’humanité à être une partie de ce « Grand soi » comme le fait Arne Næss, révèle la seule profondeur de l’ « écologie profonde » : profondément animiste et païenne.

Naguère il y avait les communistes « à visage humain » qui voulaient une église rouge, aujourd’hui il y aurait des « écologistes profonds à visage chrétien » qui voudraient une église verte. Nos trois inquisiteurs n’y vont pas par quatre chemins : « justifier une domination despotique et même parfois tyranique (sic) de l’humain sur la planète par le verset 28 du premier chapitre de la Genèse est un contresens terrible au vu de l’ensemble du contenu biblique ».
Voilà donc d’où parlent nos trois compères : « au vu de l’ensemble du contenu biblique ». Tout devient clair. Conséquence : leurs opposants sont accusés d’hérésie. Grave puisqu’elle mène à un contresens « terrible ». Encore une vieille tactique inquisitoriale pour terroriser les opposants.
Ces Maîtres de Vérité disposent-ils d’un Évangile selon saint Profond ou d’un manuscrit caché de la mer Morte ? Ils citent le pape pour appuyer leurs propos : ont-ils eu la révélation d’une infaillibilité pontificale dans son magistère social que les catholiques ignoraient ?
Évidemment, je n’ai jamais justifié une telle « domination despotique ou tyrannique » sur la planète. L’absurdité d’une telle affabulation n’échappera à personne. Le « despotisme » et la « tyrannie » signifieraient l’existence de relations politiques entre des êtres vivants qui ont une conscience : d’un côté les humains oppresseurs, de l’autre la planète opprimée. Or, la planète n’est pour moi ni un vivant, ni même un être. Je ne « justifie » donc rien de toutes ces balivernes de « despotisme » ou de « tyrannie » qui me sont attribuées.
Qu’à l’inverse, nos trois accusateurs croient de telles relations possibles démontre leur réification païenne de cet amas de particules qui tourne autour du soleil, au point d’imaginer que l’on pourrait lui faire subir une oppression dont il faudrait le « sauver ».
« Au vu de l’ensemble du contenu biblique », nos trois compères n’hésitent pas à passer par pertes et (surtout) profits, la Genèse I.26 où il est indiqué : Faisons l’humanité à notre image, selon notre ressemblance, et qu’elle domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. » Eux ont-ils une version où Dieu dit que l’humanité ne vaudrait pas plus qu’animaux, végétaux et minéraux, eux aussi créés à l’image de Dieu ?
Perspective assénée à nouveau plus loin : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. »
Dieu en rajoute : il semble avoir trouvé « bon » (ou « bien ») la création de la nature, minéraux, végétaux et animaux. Mais, après avoir créé l’humain, femme et homme : « Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici cela était très bon. » Oui, Dieu ne dit plus « bien » mais « Très bon » ou « éminemment bien »(וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת-כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה, וְהִנֵּה-טוֹב מְאֹד; ). Ciel ! et l’« égalitarisme biosphérique » ?
Même après la chute et le déluge, à la sortie de l’arche de Noé, Dieu continue à développer un « contre sens terrible » dans la Genèse : « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de toute bête de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se meut sur la terre et de tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos mains. »
Songez même qu’il incite Abraham à construire la nation juive en invoquant une prééminence humaine et qu’il exige de lui sacrifier un bélier, pourtant un vivant, au lieu d’Isaac ! Tous les vivants ne se valent-ils donc pas ? Et j’en passe d’autres passages scandaleux de cet « anthropomorphisme » qui conduit Dieu à passer une alliance avec Moïse, au lieu d’avec les animaux et des végétaux… jusqu’à nous donner à la nation juive une terre « en possession » (Genèse, Exode, Deutéronome, Josué, Nombres, Ezéchiel…), leur demandant sur ce royaume d’Israël de croître et de se développer…
Certes, en 1982, certains luthériens américains ont cru pouvoir intituler un texte « Le Terre : un don de dieu, notre responsabilité ». Ils invoquaient à l’appui de leurs thèses la Genèse (2, 15) où il serait demandé de « cultiver et de garder » avec amour la terre.
Mais ce texte concerne Adam et Éve, dans le Jardin d’Éden, en aucune façon la vie de l’humanité après la chute qui engage un rapport disharmonieux et exige la transformation infinie de la nature, comme le montrent les textes qui ont trait au royaume d’Israël et à sa croissance. On retrouve cette différence qualitative dans toutes les traditions qui évoquent ce paradis perdu appelé́ « jardin d’Éden» par juifs, chrétiens et musulmans, «Satya Yuga » par l’hindouisme, « âge d’or», par le poète Hésiode… Il suffit de se reporter pour les Grecs au mythe de Prométhée.
Paradoxalement d’ailleurs, il est dans la Bible que même dans cet Éden, il faille « cultiver » la terre. Or, cultiver est une action de transformation proprement humaine qui ne laisse pas la nature en l’état. Il n’y a pas ici d’harmonie préétablie. Et cet Éden lui-même n’est pas le moins du monde un produit naturel de la planète. Le texte (Genèse, 2,8) dit que Dieu l’a « planté ». L’harmonie relative ne doit donc rien à la planète.
C’est bien pourquoi aucun culte ne lui est dû à la différence de Dieu. Le texte hébreu dit d’ailleurs que l’humanité doit « soigner », et non garder (2,15) l’Éden. L’intervention humaine s’impose pour répondre aux desseins divins. Et puisqu’il s’agit de soigner, elle indique bien l’exceptionnalité humaine et non l’équivalence des « écosystèmes ». D’ailleurs l’Éternel précise (2,16) : « tous les arbres du jardin tu peux t’en nourrir » sans aucune considération pour les végétaux, seulement pour la seule satisfaction humaine Et c’est bien pour avoir désobéi à Dieu, et non pour avoir pillé l’Éden, que les humains sont punis.
En vérité je ne connais aucun texte qui dise l’amour dû à la planète ou l’équivalence de l’humanité avec des « écosystèmes ». Certains évêques partisans d’une « éthique de l’intendance » avaient cru, en 1980, trouver quelques lignes en ce sens dans le Lévitique (25 :23) : « Et le pays ne se vendra pas à perpétuité, car le pays est à moi ; vous, vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des hôtes ».À les en croire, Dieu aurait ainsi un jour demandé aux humains de jouer le rôle d’ « intendant » pour préserver la terre et d’en voir un usage modeste.
Or, il n’y a aucune trace à ma connaissance (certes limitée) de cette modestie d’usage demandée. Ce chapitre 25 évoque non pas la conduite à tenir de l’humanité sur les siècles à venir, mais seulement les 49 premières années d’installation de la nation juive sur les terres inhabitées d’Israël ; la cinquantième année étant le « jubilé ».
Et après 50 ans ? « Chacun d’entre vous rentrera dans son bien » ( Lev.25, 10). Ce qui est confirmé ensuite : « En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre possession. » (Lev, 25, 13) Alors ceux qui occupent les sols devront le faire fructifier et ils pourront se nourrir « abondamment » (Lev. 25,19) des produits de leur exploitation, avec le souci de la croissance, de la richesse et du bien-être dans le respect des lois divines. La suite indique : « je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera son produit, et l’arbre du champ donnera son fruit », (26-4) ou bien encore, au lieu d’évoquer une interdépendance et l’équivalence des sous-systèmes naturels : « je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles » ou « je vous ferai croître et multiplier »…Les exemples abondent.
Le texte cité par les évêques se situe durant la période qui précède le jubilé. Et uniquement celle-ci. Elle ne concerne pas l’utilisation et l’exploitation de la terre mais seulement la question juridique de la propriété individuelle et la protection des juifs qui auraient des difficultés à conserver la terre donnée par Dieu. Car juridiquement, la propriété revient de droit au premier occupant, comme cela est commun sur toute terre découverte et chacun devrait pouvoir en faire ce qu’il veut. Mais, Dieu va suspendre en partie le droit de propriété pour protéger les plus malchanceux. Ainsi, si un juif éprouve des difficultés au point de devoir vendre son bien, Dieu interdit qu’elle soit achetée « irrévocablement » durant 49 ans. Il précise : « dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez le droit de rachat sur les terres. » Celui qui a été contraint de vendre pourra ainsi racheter en priorité sa terre et le nouvel acheteur sera contraint de la lui restituer. Plus encore : celui qui est ruiné durant cetet période peut vendre le bien mais il le récupèrera juste après le jubilé.
Ce n’est pas l’humain qui est intendant, mais Dieu. Son objectif en offrant la possession mais pas le droit de pleine propriété n’est pas de préserver la planète mais l’individu élu. Avec des exceptions comme la propriété des Lévites dans la banlieue des villes qui est « inaliénable ».
Et loin d’en appeler à un culte de la nature ou du « Grand Soi », le texte indique : « Ne vous faites point de faux dieux; n’érigez point, chez vous, image ni monument, et ne mettez point de pierre symbolique dans votre pays pour vous y prosterner: car c’est moi, Éternel, qui suis votre Dieu ».(Lev, 26,1)
Et que dire finalement de tous ces textes « terribles » car « anthropocentriques » qui indiquent que la grâce est comme « la lumière qui éclaire tout humain venant dans le monde » (Évangile selon Jean) et seulement les humains ? Lumière qui permet de croire que Dieu a demandé de s’aimer les uns les autres, d’aimer même l’étranger comme soi-même (Lév, 33,34), voire qui dit « aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés » (Jean, 13-34), c’est-à-dire jusqu’au sacrifice, sans référence à l’amour pour les sous-systèmes animaux, végétaux, minéraux ? Et que penser de ces débats sur la justification par la foi ou les œuvres, puisque le salut vient de la désœuvre pour sauver les écosystèmes de la planète ? De ces sacrements qui s’adressent aux humains, aux petits « soi » mais non aux autres petits « soi », moucherons, mygales, arbres et pierres qui vaudraient pourtant autant qu’eux ? Et de ces prophètes venus pour les seuls humains jusqu’à l’annonce de cette résurrection du dernier jour dans l’oubli du « Grand Soi»?
« Contresens terrible » ? Contre le paganisme, je maintiens que moralement, socialement, politiquement, cosmologiquement, ontologiquement, l’humain est au-dessus de tout vivant et du non-vivant, qu’il n’a de comptes à rendre qu’à lui-même, sinon à Dieu, et qu’il doit croître, se multiplier, humaniser la planète et assumer dans la joie sa libre nature créatrice.


« Au vu de l’ensemble du contenu biblique », nos idéologues prétendent qu’« un véritable humanisme serait de trouver la juste place de l’humain dans une interdépendance avec le reste du vivant et de la planète ». Le mérite de leur écologie « profonde » serait « d’avoir souligné cette interdépendance au sein d’écosystèmes, de maisons communes, remettant en cause la prééminence d’une espèce, d’un individu, d’un organe qui serait central ».
« Interdépendance » ? Ce mot indique une dépendance réciproque, voire une relation biunivoque. Je n’en crois rien. Car si nul ne songe à nier l’influence que peut avoir l’environnement sur chacun, d’une part celui-ci ne se réduit pas à la terre mais comprend aussi lune, soleil… tout comme famille et différents éléments de la société civile, gènes et évolution corporelle… où est-il écrit que l’humain ne serait pas irréductible à ces relations, un être doté de liberté et de créativité, capables de jouer sur les déterminations, de les modifier, les transformer, les dominer ? Refuser de croire à cette dépendance n’est-ce pas même la condition de la vie humaine?
J’ai pour moi 7 millions d’années de vie de l’humanité face à cette nature impitoyable et l’action de notre créativité jusque sur les gènes. J’ai pour moi l’« Humanisme » réel, défini grammaticalement et historiquement et non fantasmé.
Grammaticalement, il associe « humain » et le suffixe « isme », qui vient du grec ismós (ισμός). Le « isme » désigne une vision du monde, une théorie, une idéologie, une religion qui place au centre ce dont il est le suffixe : par exemple le Bouddha dans le bouddhisme, ici l’humain dans l’humanisme.
Historiquement, le courant humaniste est né autour des études d’humanité (studiae huminitatis) qui redécouvraient les anciens et retraduisaient la Bible, particulièrement en latin comme le fit Gutenberg. Il s’est développé à partir du XVIème siècle, liant Pic de la Mirandole, Rabelais, Montaigne, Léonard de Vinci, Dürer… dans une même consécration de l’humanité, avec son exceptionnalité et ses droits, source des droits de l’Homme et sa juste place, comme plus bel ouvrage de Dieu. C’est aussi ce sens que les théologiens chrétiens lui donnent quand bien même il y eut des débats, par exemple lors de l’opposition entre Luther et Érasme. Mais ces débats portaient sur le salut par les œuvres ou par la foi, non sur le message d’amour dû à cette espèce exceptionnelle, appelée l’humanité.
Cet humanisme s’oppose à l’animisme qui durant des centaines de milliers d’années a imaginé que les écosystèmes étaient équivalents et que toute action humaine devait être compensée par des offrandes pour conserver le prétendu équilibre, dont des sacrifices animaux ou humains. Cette conception du monde a largement été démontrée en particulier par les ethnologues lors des enquêtes sur les dernières populations nomades dont je donne les références dans l’Homo creator face à une planète impitoyable et, pour ma faible part, lors de mon étude in situ sur les indiens Yanomami. Cet humanisme s’oppose aussi à tous les paganismes qui refusaient aussi cette suprématie de l’humanité, son universalité et acceptaient le sacrifice humain. Il s’oppose encore à toutes ces théories venues du marxisme qui dénonçaient l’humanisme comme une illusion bourgeoise et aux théories raciales, qui sont, au fond, une résurgence de l’animisme.
Appeler « humanisme » une idéologie qui nie la prééminence humaine et imagine que nous serions des éléments en « interdépendance » dans ce « Grand Soi » avec lequel nous devrions communier ? Voilà l’imposture. En fantasmant sur un être-planète, en mettant les systèmes vivants en équivalence, en refusant à l’humanité sa liberté et le droit de dominer la nature et de croître, en propageant une vision païenne animiste, l’ « écologie profonde » démontre seulement son antihumanisme …profond.
Afin de stigmatiser leurs opposants et de se présenter, contre eux, en défenseurs de la liberté et des nations opprimées, les partisans de l’« écologie profonde » les accusent de défendre « une civilisation née en occident, qui s’est imposée de manière impériale et a mêlé le meilleur sur le plan culturel et sociétal et le pire : colonialisme, esclavagisme, oppression des cultures considérées comme primitives.
On s’amusera devant ces poncifs de l’extrême-gauche tiers-mondiste des années soixante et cette critique sur un site protestant, de la « civilisation née en occident » dont le christianisme est pourtant l’un des fondements.
Ces Tartuffe feignent d’ignorer que toutes les civilisations, oui toutes, ont été esclavagistes, colonialistes, impérialistes, oppressives depuis le néolithique, commencé il y a 12 000 ans. Et si quelque chose de spectaculaire et de nouveau, propre aux civilisations européennes sous influence chrétienne est arrivé n’est-ce pas l’exigence de l’abolition universelle de l’esclavage et le respect des nations, au nom d’une « prééminence » humaine, qui place l’humanité au-dessus des animaux et d’autres « écosystèmes » auxquels on réduisait jusqu’alors certains humains ? Est-ce même un hasard si les thèses anticolonialistes, antiimpérialistes, le droit des nations à disposer d’elles-mêmes ou les droits de l’homme sont nés en occident et non dans ces régions du monde ou dans ces époques où l’on pensait que les « écosystèmes » humains, animaux, végétaux et minéraux se valaient ?
N’ont-ils donc jamais entendu parler, ces idéologues si « profonds », de l’esclavagisme, du colonialisme et de l’impérialisme à Sumer, au IVème millénaire avant J.-C. ? À Uruk ? Chez les Hittites ? Les Assyriens ? Les Scythes ?… Les Grecs cela ne leur dit rien ? Et Athènes, où se trouve plus d’esclaves que de citoyens tandis que dans toute l’Attique on compte, vers -317, 21 000 citoyens pour 400 000 esclaves ? Et l’empire romain, jamais vu, jamais rencontré, il n’aurait été ni esclavagiste, ni colonialiste, et il n’aurait pas, comme tous les autres, opprimé des populations jugées plus primitives, appelées « barbares », y compris quand il fut dirigé par un empereur « noir » comme l’empereur Septime Sévère ?
L’Asie, ils ne connaissent pas non plus ? Trop petite peut-être ? Car tous les royaumes et empires orientaux étaient esclavagistes, colonialistes, oppressifs… comme ces Javanais qui, cherchant la paix avec les empereurs Ming (1348-1644), parmi les offrandes, leur donnent 30 000 esclaves africains, en 1381, à Hongwu. Ignorent-ils la distinction, dans la dynastie Tang (618-907), entre les Hans, investis par les esprits de la nature, et les autres humains, qui peuvent être mis en esclavage, colonisés ou tués au nom de cette même nature ? L’impérialisme et les marchés aux esclaves des royaumes de Kediri, Singasari, Majapahit… en Indonésie, pas vus non plus ? Plus de 2000 ans d’esclavage au Japon ? Et en Corée depuis au moins les Trois Royaumes (-57 ; 668) ? Et en Inde, où l’on trouve encore aujourd’hui 15 millions d’esclaves ? C’est Albertine disparue, le charme de Proust en moins ? L’empire ottoman serait-il issu d’une bande dessinée ? N’aurait-il pas été esclavagiste, colonialiste, impérialiste, oppressif ? Est-ce parce qu’il vend des esclaves noirs et, surtout, blancs, jusqu’en 1890, et même, encore en 1913 à Constantinople, que les idéologues gauchistes de l’écologie profonde mettent aux oubliettes terreurs et malheurs de l’Europe orientale et d’une partie de l’Europe centrale ? « L’impôt sur le sang », ou Devchirmé, qui contraignit durant trois siècles tous les villages à donner aux Turcs leurs fils ainés, à partir de 6 ans, pour être esclaves (60%) ou soldats, et certaines de leurs femmes choisies pour aller dans les harems avant d’être exécutées quand elles devenaient « hors d’usage » ? Des blancs chrétiens, donc cela ne compte pas ?
Et l’Afrique, elle n’existe que pour condamner l’Europe chrétienne ? Faudrait-il se taire sur la traite transsaharienne et maritime des tribus africaines par les tribus arabes et berbères à partir du VIIIème siècle, probablement entre 12 et 15 millions de morts ? Il ne faudrait pas se demander pourquoi il n’en reste aucun descendant survivant alors qu’un Président métis peut être élu aux États-Unis et quelques descendants d’esclave devenir maires, députés, sénateurs, ministres ou chefs de gouvernement dans nos terribles démocraties « occidentales » ? Au passage n’ont-ils donc jamais entendu parler de l’esclavage des dizaines de milliers de blancs par les pirates « barbaresques », de l’esclavage entre tribus arabes ou de l’impérialisme et du colonialisme des empires africains de Gao puis Songhaï, du Ghana, du Mali, des royaumes du Buganda, du Burundi, du Rwanda… ? L’Afrique n’existe donc pas avant le colonialisme européen faute de convenir à leurs contes à dormir debout ?
Non, l’Européen qui défend la liberté n’a pas plus à se battre la coulpe de ce que ses ancêtres ont fait en matière d’esclavagisme et d’oppression que tout autre population de ce globe. Pas plus qu’il ne doit culpabiliser d’avoir eu des ancêtres anthropophages car tous nos ancêtres le furent, y compris ceux de l’« écologie profonde », pour célébrer, comme eux, les esprits de la nature et rétablir la prétendue harmonie naturelle.
Ce qui fantastique ? Que dans certains pays européens, des consciences se soient levées pour exiger l’abolition universelle de l’esclavage contre ceux qui ne voulaient pas de la « prééminence » humaine. Qu’y fut découvert le droit des nations à disposer d’elles-mêmes ; moralité inachevée car il n’est pas un continent où je ne vois des populations opprimées.
L’ « écologie profonde » ? Expression du vieux monde qui affaiblit les démocraties représentatives occidentales et qui continue à vouloir imposer en bobos colonialistes leur modèle à toutes les nations, y compris pauvres, jusqu’à freiner leur développement et imposer cette chimérique décroissance économique et démographique. Non pas le point de vue de la liberté mais celui des ennemis de la liberté.
Avant d’en terminer, les inquisiteurs vendent l’apocalypse qui vient si on osait s’opposer à eux : « on sait aujourd’hui quel est le tendon d’Achille de la nôtre (civilisation). Elle est dépendante de la fuite en avant d’une croissance technologique et industrielle illimitée qui épuise les ressources d’une planète limitée. » Prenant en référence le « rapport Meadows » de 1972, ils dénoncent « les mesurettes qui sont prises de manière dispersée (…) loin d’être à la hauteur des discours sur la planète qui brûle ».
Qui est donc ce curieux « on sait » qui interdit de penser hors de leurs cadres ? L’objectif est de briser toute contestation dans l’œuf et de l’isoler en se référant à un prétendu consensus. Ils reprennent les couplets d’Arne Næss contre l’écologie « superficielle » et ses « mesurettes » au nom d’une « planète qui brûle ». Et pour preuve définitive, ils citent ce « rapport Meadows » de 1972 qui, 50 ans après, fait sourire. Les auteurs n’annonçaient-ils pas que la mise en culture des terres, en raison de la démographie, serait de plus en plus couteuse, conduirait à la disette et à des problèmes insurmontables d’approvisionnement en eau potable ? Que les ressources énergétiques comme pétrole, gaz, lignite, seraient insuffisantes et nous condamnant à la pénurie ? Que la pollution nous tuerait ?
Loin d’être le « talon d’Achille » des démocraties occidentales (et orientales), la « croissance technologique et industrielle » fut la clef de leur survie et du mieux-être de leurs populations. Ce n’est pas un hasard s’il n’y a jamais eu autant de pays pour suivre ce modèle de « course » à la croissance et aux technologies : car ça marche !
Ce modèle de croissance est si efficace que sur les 10 premières puissances mondiales en 2019, 10 jouent cette « course ». Sur les 20 premiers pays selon l’indice de qualité de vie, tous la jouent aussi.
À l’inverse, le refus de ce modèle ou l’impossibilité de le mettre en œuvre caractérise les populations les plus misérables de la planète.
Certes, j’admets la « fuite » vers la croissance et les technologies. C’est la course pour fuir la misère et diminuer la souffrance humaine. Cette course qui caractérise tant de pays qui subissaient la famine, comme la Chine ou l’Inde.
Il y avait 3,7 milliards d’habitants au moment du rapport Meadows, 7,85 milliards aujourd’hui. Or, loin de l’apocalypse annoncée, grâce à la croissance et aux aides internationales, la famine a considérablement reculé. Il y avait 36% de la population en sous-alimentation en 1970, 20% en 1990, 12,9 % en 2015, 10,8% en 2018, 8,9% en 2019. Les dernières famines massives, celles de la Péninsule indienne, datent de 1973 et 1974, les autres sont dues aux conflits militaires (Éthiopie, Somalie…). Des conflits dont la caractéristique économique majeure est qu’ils empêchent… la croissance.
Et si environ 690 millions de personnes restent en état de sous-nutrition aujourd’hui, la moitié se trouvent dans les zones de conflits. Même cause, mêmes effets : freins de la croissance et misère. La vraie crainte ? L’augmentation de la sous-alimentation en raison du Covid-19 naturel, qui freine la fameuse « course » au progrès dénoncée par nos idéologues.
Les expressions comme « insécurité alimentaire », « sous-alimentation », « au bord de la famine » révèlent tout à la fois le chemin encore à parcourir, car cette sous-nutrition est une réalité, et celui qui l’a été, car la famine disparaît. Oui, a disparu la famine que j’ai vue en Inde où dans ces matins blêmes à Delhi et Calcutta les corps étaient jetés dans des bennes, celle que j’ai vue au Bengladesh où les enfants mourants nous regardaient de leurs yeux noirs si grands que notre propre souffrance s’y noyait.
Ce qui est nouveau : l’accélération de la distribution des bienfaits grâce à l’abaissement rapide des couts, aux nouveaux modes de distribution, aux technologies et à la conscience morale que nous participons tous de la même humanité, cette espèce exceptionnelle qui a la prééminence sur terre.
Ce qui est ancien : que des démagogues tentent de profiter de la souffrance et des injustices pour vendre leur idéologie au lieu d’aider les pays les plus pauvres à entrer dans la dynamique de la créativité qui permet la croissance.
Oui, la population n’est pas trop nombreuse, cette vieille lune reprise depuis Malthus par tous ceux qui n’ont aucune vision de la créativité humaine qui règle toujours les problèmes qu’elle se pose, en avançant. Il était faux hier, avec le rapport Meadows, de prétendre que les ressources énergétiques seraient rares et en voie de disparition. Faux aujourd’hui. Comme je l’ai déjà prouvé dans Le Bel Avenir de l’Humanité, et rappelé sur quelques points résumés dans l’article incriminé, les solutions sont en nombre pour extirper l’énergie à notre disposition. La révolution des nanotechnologies, par exemple, avec son mode de production « bottom up » ans déchets, ses solutions pour transformer même le CO2… ou la révolution des biotechs, par exemple l’usage industriel et agricole des « ciseaux génétiques » (CRISPR-Cas9)… et toutes les autres technologies démontrent que l’humanité ne pose pas de questions auxquelles, par sa créativité illimité et libérée, elle ne pourrait répondre.
Et la planète ne brûle pas. Sinon lorsque se réveillent des volcans ou que les tremblements de terre détruisent les villes. Elle se réchauffe me dit-on ? Je veux bien le croire. Mais la réponse n’est pas la recherche d’un équilibre impossible dont les esprits de la nature auraient donné les clefs aux Maîtres de vérité de l’écologie profonde après leur avoir offert celles de la Bible. Contrairement à leur vision démagogique et orgueilleuse, vu les forces titanesques à l’œuvre, pour la part qui revient à l’humanité, comme face aux pollutions, les solutions se trouvent dans le savoir et dans une morale joyeuse qui croit en l’humanité et en son esprit de responsabilité. C’est pourquoi, puisque nous avons besoin de financer cette course illimitée aux savoirs pour alléger le malheur, nous ne souffrons pas de trop de croissance, mais de pas assez.
 Il n’est pas anodin que les trois auteurs, à l’image de tous les idolâtres rouges-verts de la planète, m’accusent de « réduire la santé à la dynamique d’une industrie pharmaceutique et des biotechnologies » ce qu’ils dénoncent comme « un raccourci très réducteur ». Et pour vendre leur idéologie, ils inventent que jusqu’au début du 20e siècle, la santé se définissait comme « l’aptitude au travail et à la jouissance » dans une perspective d’adaptation à une société industrielle occidentale fondée sur la production et la consommation. Aujourd’hui, on prendrait « conscience que la bonne santé de l’humain passe par celle du vivant qui nous environne ». Ils donnent l’exemple des bons microbes dont ils ont entendu parler qui favoriseraient notre système immunitaire. Communier avec la nature serait le chemin pour la sauver et nous en même temps.
Il n’est pas anodin que les trois auteurs, à l’image de tous les idolâtres rouges-verts de la planète, m’accusent de « réduire la santé à la dynamique d’une industrie pharmaceutique et des biotechnologies » ce qu’ils dénoncent comme « un raccourci très réducteur ». Et pour vendre leur idéologie, ils inventent que jusqu’au début du 20e siècle, la santé se définissait comme « l’aptitude au travail et à la jouissance » dans une perspective d’adaptation à une société industrielle occidentale fondée sur la production et la consommation. Aujourd’hui, on prendrait « conscience que la bonne santé de l’humain passe par celle du vivant qui nous environne ». Ils donnent l’exemple des bons microbes dont ils ont entendu parler qui favoriseraient notre système immunitaire. Communier avec la nature serait le chemin pour la sauver et nous en même temps.
En ce qui concerne le « raccourci très réducteur », nos inquisiteurs se posent là. Car où ai-je écrit qu’il fallait se fier aveuglément à l’industrie pharmaceutique et aux biotechnologies ? Nulle part. Falsifier est évidemment plus facile pour condamner. Et dénoncer démagogiquement les industries pharmaceutiques permet de trouver quelques soutiens gauchistes et populistes.
Leur concept de santé comme « aptitude au travail et à la jouissance »? Il n’a jamais existé, seulement dans leurs fantasmes anticapitalistes qui servent à vendre leur idéologie. L’idée de préserver la santé apparaît dès les Âges des Métaux sans aucun souci ni de rentabilité, ni de jouissance. En rupture avec l’animisme, à partir au moins de l’école de médecine de Cnide, vers – 700 av. J.-C., puis, plus tard, celle d’Hippocrate (-460, -377), à Cos, les Grecs considèrent ainsi le corps humain dans son dysfonctionnement en visant son rétablissement dans le souci d’un état de bien-être global, physique, mental et social, ce pour quoi, par exemple, les rites autour du dieu Asclépios sont associés à la médecine. Un processus similaire se déroule en Égypte, qui met en place la pharmacopée, avec déjà des produits « chimiques » et les premières prothèses connues non pour amener au travail ou à la jouissance mais à l’harmonie. D’ailleurs, la première prothèse connue est celle de la fille d’un prêtre égyptien.
Mais avec la découverte de la « santé », cette harmonie recherchée n’est en aucun cas une harmonie avec la nature. Mais contre les maux qu’elle occasionne. À la manière d’Aristote, lui-même fils de médecin, et d’Hippocrate, le souci de la santé et ainsi dès l’origine celui de l’homme et de sa « prééminence ». D’où le serment attribué à Hippocrate qui vise ce bien être global : Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice. » « À leur avantage » : l’ »anthropocentrisme » est bien la clef et soigner le corps humain pour qu’il résiste aux agressions naturelles et s’améliore, fut-ce par des plantes arrachées au sol, l’objectif de la santé.
Une vision qui se dégageait peu à peu de l’animisme du chamanisme qui transportait ce fantasme de l’« écologie profonde » selon lequel la santé de l’humain passerait par « celle du vivant qui nous entoure ». Les chamanes pensaient en effet que les problèmes de santé seraient dus aux dérèglements de la nature dont les humains seraient responsables. Ainsi, pour les Yonamami du haut-Orénoque au Venezuela, où tous les écosystèmes se valent, humain, jaguar, banane, fleuve et roches, la maladie se pense comme rupture disharmonique avec la planète due aux humains. « Un puma tué, une banane enlevée, une feuille de palmier ôtée : c’est un esprit « en moins ». Il va falloir se faire pardonner d’avoir ainsi retranché par ses activités des esprits à la nature, des esprits végétaux ou animaux. Il va falloir compenser ce vol en donnant un équivalent « en plus ». Une sorte de troc des esprits. (…) Ainsi, manger des fruits du palmier est bon pour les Yanomani qui peuvent troquer cela contre une prière ou une offrande, sauf pour une femme qui a ses premières règles, qui n’a pas droit au troc, et qui serait alors sanctionnée par un éborgnage de son mari, via une épine de ce même esprit- palmier qui viendrait se ficher dans l’œil. (…)» (L’Homo creator face à une planète impitoyable) Malheur à la tribu qui ne chercherait pas à communier avec les « écocystèlmes » !
Nos experts en eau profonde ont même découvert des bactéries sympathiques pour appuyer leurs dires. Ce qui les rend plus animistes encore que les chamanes qui imaginaient, à côté d’esprits bienfaisants, des esprits mauvais qu’il fallait séduire par prières et sacrifices.
Certes, il y a un millier de sortes de bactéries dans le corps mais dans quelle pochette surprise ont-ils découvert qu’elles étaient nécessairement conviviales et anodines à condition de tenter la vie en harmonie dans le « Grand Soi » et de ne pas laisser se développer croissance et capitalisme ? Les humains morts il y a plus 510 000 ans de la tuberculose, avaient-ils trop célébré l’industrie dans leurs abris sous roche ? Et ceux qui ont été tués par la syphilis, il y a 1,5 million d’années ? De la coqueluche, il y a 2 millions d’années ? Gentils les petits virus, si on ne les chagrine pas ? 200 espèces pathogènes, c’est pour se venger ? A coups de variole, d’encéphalite… de virus T-lymphotropique transmis par les gentils animaux qui cause la leucémie au paléolithique peuvent-ils être courtisé s? Et les cancers comme celui des os, qui existent depuis au moins 1,95 million d’années seraient-ils dus à la pollution … du paléolithique ? Vivre en harmonie avec Gaïa permettrait donc d’éviter les 6 000 maladies génétiques, dont nombre sont prouvées depuis des milliers d’années ?
Plus près de nous le tiers de la population d’Athènes mort de typhoïde en – 430, la disparition de 10% de la population de l’empire romain par la peste entre -165 et -170, l’épidémie de variole qui tua jusqu’à 5 000 individus par jour à Rome au IIIème siècle, et qui ravagea jusqu’à l’Égypte ?… tout cela serait dû à la « course à la croissance » et à un manque de prise en compte des autres vivants ?
Oui, j’ai écrit que « la santé impose le progrès » et celui-ci, les sciences. Ce que le traitement du Covid-19 prouve encore. Ai-je écrit que le progrès n’impose « que » les sciences ? Comment ignorer les règles d’hygiène, l’alimentation, les comportements etc… ? Au passage, sont-ils à ce point ignorants qu’ils réduisent les sciences aux « biotechnologies rouges » qui concernent la santé ? Et ne pourraient-ils s’intéresser aux « biotechnologies jaunes » dont l’objectif est de résoudre les problèmes environnementaux, ou aux « biotechnologies vertes » qui améliorent agriculture, élevage et agroalimentaire, essentiels contre la sous-nutrition ?
Comment financer sans croissance ? Par quelle opération de Saint Profond ? Le coût moyen de production d’un médicament ? Entre 800 millions et 1,5 milliard de $. Est-ce un hasard si les biotechnologies représentent plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation dans les seuls pays riches ? Et si les sociétés les moins prospères sont aussi celles qui souffrent le plus de problèmes sanitaires ?
La santé de la planète ? L’idée que la bonne santé des humains passerait par celle des autres vivants ? Des chimères qui démontrent l’archaïsme de ces « écologistes profonds » qui ont la profondeur des abysses de leurs eaux glacées.
Avec le camp du progrès, je maintiens cette proposition de bon sens : « La santé impose le progrès donc les sciences, donc la croissance ». Grâce à l’industrialisation et aux laboratoires, grâce aux technologies et aux savoirs, grâce à cette domination chaque jour plus conquérante de la planète, il n’y a jamais eu autant d’espoir pour lutter contre les souffrances qui assaillent l’humanité. Et quand bien même on m’annoncerait une apocalypse, je continuerais à défendre cette nature créatrice humaine qui humanise cette planète. Comme le disait Martin Luther, « si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier ».

L’homo creator face à une Planète impitoyable
Livre imprimé couleur luxe : contemporary bookstore ; Livre imprimé noir et blanc : amazon ; Contemporary Bookstore ; libraires… Epub et e-mobi : Kindle ; kobo ; contemporary Bookstore; google play…
Le Bel Avenir de l’Humanité
Livre imprimé : Calmann-Lévy ; Amazon ; FNAC ; libraires… E-pub et e-mobi : Calmann-Lévy ; Amazon ; Google…
©YInternationalConsulting
©YvesRoucaute
( publié dans Regards protestants)
« Sauvons la Planète», implorent les uns, «Make the Planet great again», gémissent les autres qui pensent peut-être qu’en anglais la formule serait un tantinet moins ridicule. Difficile de ne pas rire de ces Don Quichotte de l’écologie profonde, qui ont troqué leur cheval pour le vélo, écologie si profonde que nul d’ailleurs n’en voit le fond. Curieusement, cet engouement fervent pour célébrer les bienfaits de la fameuse Gaïa-la-Terre quand un virus bien naturel, le Covid-19 décime l’humanité, ne les conduit pourtant pas à aller chercher au magasin bio du coin le produit naturel qui y mettrait fin. Car je les vois, dès qu’ils ont quitté les plateaux télévisés, espérer, comme le quidam ordinaire, une solution du côté des produits bien artificiels, bien biochimiques, bien génétiquement modifiés, ce que l’on appelle communément médicaments et vaccins. Sans idéologie, ils applaudiraient même Le Bel Avenir de l’Humanité qui démontre, contre les apocalyptiques, que la vraie écologie est incarnée par le camp du progrès, seul apte à mettre l’humanité au cœur de sa pensée et à résoudre, notamment par les nouvelles technologies, les défis de la planète, pollutions comprises.
Hélas, il n’en est rien. Et si l’idéologie rend aveugle, elle ne rend malheureusement pas muet. En pleine pandémie, nos écologistes de l’écologie punitive, spécialistes de la mauvaise conscience et inquisiteurs des partisans du progrès, continuent à vendre la plus vieille idolâtrie qui soit, celle de la Terre. Ils osent tout et c’est même à cela qu’on les reconnaît. Pollutions, réchauffement, maladies, chômage… tout est bon pour contrôler nos vies. Jusqu’à attribuer les virus, dont le Covid-19, à une faute, celle de l’humanité punie par la fameuse Gaïa, irritée par l’industrialisation, la croissance, la consommation, la mondialisation, et plein de trucs qu’elle jugerait détestable en son for intérieur, ce for intérieur auquel nos prêtres de l’« écologie profonde » auraient directement accès.
Faisons le point, en revenant au vrai fond, les fondements. Et en montrant la voie de résolution des problèmes.
La vraie écologie
Écologiste ? La barbe ne fait pas l’écologiste. Et quand bien même la rime est troublante, l’écologie n’est pas nécessairement condamnée à être parente de l’idéologie. Cela même si je vois bien que savoir regarder le thermomètre, les mottes de terre et les opuscules des apocalyptiques, paraît bien plus judicieux que s’intéresser aux sciences et lire la Bible qui, au-delà des 9 premiers paragraphes, montrerait une rare incorrection au point de demander aux humains de dominer et soumettre la planète et même d’assujettir tout ce qui s’y trouve. Gaïa, n’autorise pas pareille désinvolture.
Écologiste ? J’ose dire que je le suis. Mais vraiment. Je veux dire sans idéologie. Rien d‘exceptionnel : tous les partisans du camp du progrès le sont, évidemment. Ou, plus exactement, seuls ils le sont. Car ils mettent l’humanité en avant, contre les idolâtres de la planète. Le mot écologie signale la mystification de l’écologie profonde : éco vient de oikos (οἶκος) qui signifie maison en grec, et non planète ou nature; l’écologie profonde a clairement, avec la langue grecque, le plaisir de ne l’avoir jamais rencontrée. Or, qu’est-ce qu’une maiso n? Désolé pour le lecteur qui doit se dire que je perds beaucoup de temps à enfoncer les portes (des maisons) ouvertes. Mais comment faire autrement ? Car une maison n’est pas un don de la planète, miraculeusement issu des fameuses mottes de terre et du travail de sympathiques insectes. Dès son origine, c’est une construction produite par la créativité humaine à partir de bois, de pierres, de peaux, d’os… arrachés à la planète, aux forêts, aux minéraux, aux animaux… L’objectif de la maison ? Protéger l’humanité contre les menaces de la planète et non l’idolâtrer. Condition indispensable pour se multiplier et vivre libres. Un symptôme : l’humanité ne peut vivre sans domestiquer la planète. Toujours mieux et toujours plus. Songez aux 17 glaciations et autant de réchauffements, inconnus de nos écologistes archaïques profonds, lors des seuls derniers 2,6 millions d’années, aux éruptions volcaniques, aux tremblements de terre, tempêtes, tornades, tsunamis… Aux maladies dues aux virus, aux bactéries, aux gênes… Aux attaques de ces animaux qui traquaient avec ruse et force nos ancêtres, qui traquent encore les dernières populations nomades humaines… Toutes menaces qui existent encore.
Oui, l’écologie qui répond à son concept, celui de tenir un discours rationnel sur la « maison », symbole des artifices qui protègent l’humanité et lui permettent d’aller, par le progrès, de la survie au maximum d’harmonie possible, ne met pas en avant la protection de la planète et des espèces qui y vivent, mais l’humanité.
L’écologie positive s’inquiète seulement de ce sur quoi elle peut agir, sans imaginer des grigris et des sacrifices absurdes au bénéfice d’une planète qui n’a ni conscience, ni projet. Trois éléments sont pris en compte : la part de déséquilibre qui pourrait nuire à l’humanité, dont elle serait responsable et, enfin, celle sur laquelle elle pourrait agir.
Contre l’écologie négative, je me contenterai dans ce court billet de rappeler ici, en les résumant, quelques-uns des faits rapportés dans mes deux derniers livres. Les lecteurs me pardonneront.
Le CO2 est-il maudit ?
A cause du CO2 maudit, il faudrait nous faire pardonner nos atteintes à la planète ?
Le CO2 ? Il est indispensable à la vie sur terre. Sans cette couverture chauffante, les rayons naturels radioactifs gamma et X mortels du soleil ne sont plus arrêtés et les rayons infrarouges qui transportent la chaleur ne peuvent plus passer. Équilibrer les effets de serre du dioxyde de carbone et du méthane ? Le premier réchauffement climatique monstrueux eut lieu dès la naissance de la Terre, il y a 4,5 milliards d’années. Et, faute de CO2, il y a eu des situations de terre entièrement gelée, dite Terre boule de neige (Snowball Earth), équateur compris, comme il y a 635 millions d’années. Entre explosions nucléaires du soleil, angle de l’orbite et axe de rotation terrestre, les déséquilibres de l’atmosphère, les innombrables épisodes glaciaires et réchauffements monstrueux depuis 4,5 milliards d’années, dont le dernier s’est produit il y a seulement 12000 ans, rendent difficiles la vie humaine sans que celle-ci, apparue il y a 7 millions d’années, puisse évidement en être tenue pour responsable.
Et la solution au déséquilibre se trouve dans le progrès non dans son arrêt. Cessons ces larmes de crocodile destinées à alimenter les fantasmes des idolâtres. Au lieu de regarder du côté de la forêt amazonienne et de pleurer sur la disparition des espèces, dont 90% ont déjà disparu en 20 millions d’années, regardons du côté des labos qui créent des feuilles artificielles qui imitent, en mieux, les feuilles naturelles à partir d’oxyde de cuivre pour prendre le CO2 et le transformer en oxygène et méthanol. Et les pièges bleus qui transforment le gaz à effet de serre en air pur et en énergie en imitant la longueur d’onde bleue du soleil et en passant par un réseau métal organique qui brise les molécules de dioxyde de carbone. Et ces instituts qui utilisent des nanoparticules de cuivre dans des nano-aiguilles de graphène pour transformer le CO2 en éthanol ou qui modifient des enzymes pour provoquer une photosynthèse 20 fois plus rapide que la photosynthèse naturelle.
L’énergie inépuisable
Non, l’énergie n’est pas épuisable. Les fermions, quarks et leptons, ainsi que les bosons contiennent une énergie infinie. Ils sont de l’énergie potentiellement inépuisable dont les laboratoires extirpent peu à peu les virtualités. Comment pourraient-ils demain manquer ? Ils composent l’univers. Nous sommes arrivés tout juste à mettre le bout des doigts de pied sur les pentes de l’Himalaya. L’énergie à extirper dans la nature est infinie comme nous venons de le voir par l’exploitation du CO2 via les nanotechnologies. Toutes les technologies vont dans ce sens. Par la biologie synthétique avec ses bioréacteurs cellulaires artificiels peuvent même être fabriquées des hydrocarbures sans exploitation des sols… Les déchets actuels ? Eux-mêmes sont des réservoirs d’énergies utilisables. Les déchets futurs ? L’assemblage des atomes, fabriqué localement, alimenté par les cellules ou les énergies solaires, n’en crée guère. Moins que les éoliennes.
Nous vivons l’explosion de la production de combustibles à partir des matières premières et la réduction de la consommation de certaines sources d’énergie polluante. Ainsi pour les véhicules. Nous n’arrêtons pas la pollution en revenant au transport en commun ni au vélo obligatoire pour tous dans les centres des villes, handicapés, femmes enceintes, personnes âgées et bambins compris, mais en investissant dans toujours plus de progrès. Ainsi la voiture électrique autonome individuelle et la voiture sur coussins d’air qui abolira demain pneus et routes goudronnées, ne sont pas issues du retour à la charrette et de génuflexions devant la fumeuse Gaïa mais de l’exploitation et de la domination des éléments de la nature.
Il n’y a pas trop d’humains
Nous ne souffrons pas de trop d’humanité, mais de pas assez : 100000 ancêtres il y a trois millions d’années, un milliard en 1800, six milliards en 1999, 7,6 milliards aujourd’hui. Où est la catastrophe annoncée par Thomas Malthus au 19e siècle ? Entre 1800 et aujourd’hui, la population mondiale est passée de 1 milliard à 7,5 milliards et, grâce à la croissance, elle a survécu.
Toujours plus de misère, de pauvreté ? De misère intellectuelle sans doute, si j’en juge par l’attrait pour les idolâtres de la planète. Mais où est le désastre humain programmé par le rapport apocalyptique de Donella et Dennis Meadows en 1972? La famine est en diminution constante : 24% d’affamés en 1990, 14% en 2017, 9% aujourd’hui. Elle disparaîtra en quasi-totalité d’ici 2030 non pas par l’arrêt des innovations mais grâce à elles, comme celles de la biotechnologie qui crée même des steaks, au goût de steack, bientôt pour moins de 1 dollar, sans tuer d’animaux.
Quand nos apocalyptiques manifestent contre les Organismes génétiquement modifiés (OGM) et attaquent les champs de blé à coups de machettes, la machette signale tout à la fois leur appartenance au genre humain, qui dut créer des outils pour se nourrir en partant à l’assaut de la planète, mais aussi leur pathétique degré d’évolution. Car ces OGM, ils les ont depuis leur naissance dans leurs assiettes. Et leurs parents. Grâce à cela, ils ont survécu. Ainsi, il y a 12000 ans, quand les humains arrêtent leurs pérégrinations au Moyen-Orient, de la vallée du Jourdain à celle de l’Euphrate, le froment n’existe pas et la plupart des espèces animales domestiquées non plus. Les espèces de blé sauvage qui sont devant eux se dispersent avec le vent et elles se fragmentent. Nos ancêtres décident alors de sélectionner, grain à grain, ce blé sauvage pour obtenir une nouvelle espèce, modifiée et résistante. Ils s’attaquent même à ses enveloppes membraneuses : l’archéologie atteste que celles-ci n’étaient pas détachables, ce qui interdisait vannage et battage. Et ces grains, qui étaient trop petits et, hélas, dépourvus de gluten, ils les transforment. Et quel succès ! Ainsi sont nés les blés, le blé dur comme le froment, qui ont sauvé la vie de millions d’humains.
La santé impose le progrès donc les sciences, donc la croissance
Contre les errements des Don Quichotte écologistes, l’écologie positive rappelle que notre première maison est notre corps et que la protection de ce corps contre les agressions et les erreurs de la nature, des maladies virales aux maladies génétiques, ne se peut sans le progrès et, celui-ci, sans la croissance.
Prétendre que l’industrialisation et une prétendue surconsommation (quand tant de gens souffrent encore de malnutrition) seraient responsables des cancers ? L’archéobiologie le démontre malgré la difficulté évidente de travailler sur les organes mous : les cancers existent depuis au moins 1,95 million d’années et le nombre de cancers prouvés au paléolithique supérieur est important, y compris des cancers du cerveau.
Les virus et bactéries ? Ils existent depuis des millions d’années. La tuberculose ? Prouvée il y a 510000 ans. Infections mycobactériennes non tuberculeuses et le bacille de la lèpre sont prouvés dès le paléolithique moyen en Afrique de l’Est. L’ensemble des maladies produites par les tréponèmes, comme la syphilis ou la pinta, sont apparues il y a 1,5 million d’années. La coqueluche (bacille Bordetella pertussis), il y a 2 millions d’années.
Plus proches de nous, la typhoïde, les cancers du foie, de la rate, de la prostate, la malaria, les maladies cardiovasculaires sévissaient en Égypte antique il y a 3500 ans, comme le prouvent les momies. Les épidémies monstrueuses n’ont pas attendu l’industrie et la mondialisation comme le prouve la fameuse peste antonine, en vérité une variole qui a tué 10 millions de personnes sur 64 millions dans l’empire romain entre 165 et 190 après J.-C. Oui, 15% des habitants au moins. Et la rougeole a fait depuis 200 millions de morts, du 7e siècle au début du 20e.
Et que dire de la peste noire qui a exterminé 25% la population européenne entre 1347 et 1352. Et des choléra, typhus, variole qui ont exterminé des villes entières et décimées des régions au Moyen-Âge ? Tout cela serait-il donc dû à une vengeance de Gaïa qui aurait trouvé insupportable les deux roues tirées par des mulets pollueurs ?
Même les exemples prétendument probants des idolâtres de la planète prêtent à sourire. Le virus de la grippe espagnole, qui fit 40 millions de morts et un milliard de malades était-il armé d’une conscience lui disant qu’il fallait punir les humains de l’industrie et du commerce ? Hélas pour nos Don Quichotte et leurs Sancho Pança, ce virus naturel venait de… Chine, avant de gagner les États-Unis en 1918 puis de se propager en Europe et, enfin, au reste du monde. Or, la Chine d’alors n’est guère industrialisée. Gaïa-la-sotte aurait donc commencé à punir un pays sous-développé, qui connaissait famine et misère faute d’industrialisation avant de punir les humains qui voulaient s’industrialiser ?
Pourquoi d’ailleurs grippe asiatique de 1956 et grippe de Hong-Kong de 1968 frappent-elles d’abord des régions d’Asie qui n’ont pas encore choisi de jouer la mondialisation, la consommation et la croissance au lieu de commencer à Central Park ou au Bois de Boulogne ? Pourquoi même notre Gaïa, a-t-elle balancé au Nigeria, en 1969, sa fameuse fièvre de Lassa qui tua exclusivement au Nigeria, en Guinée, au Liberia, en Sierra Leone des populations essentiellement agricoles et misérables… mais qui épargna tous les pays développés ? Et je n’évoque pas le virus Ebola ou la méningite bactérienne de 2009-2010 qui ont ravagé l’Afrique. Myope, la Gaïa ?
La véritable écologie veut préserver la maison corporelle humaine car «ceci est très bien». Elle sait que l’avenir de l’humanité, notamment la lutte contre les maladies génétiques, virales et bactériennes, contre le vieillissement même, ce sont les biotechnologies, les nanotechnologies, l’intelligence artificielle, la robotique… qui en ont la clef.
C’est pourquoi, contre la théorie de la décroissance de l’écologie idolâtre, elle veut toujours plus de croissance pour financer les recherches. Et elle salue les avancées des sciences comme cette découverte d’Emmanuelle Charpentier (dont hélas, les travaux doivent peu à la France) et de Jennifer Doudna, qui viennent de recevoir le Prix Nobel de chimie pour avoir révolutionné l’ingénierie génétique avec leurs ciseaux moléculaires (CRISPR/Cas9) capables d’inactiver des gènes et d’en contrôler l’utilisation pour traiter les maladies hérédités de la nature, les gènes altérés par la nature, soigner les cancers venus du dysfonctionnement naturel.
Je pourrais ainsi continuer sur des pages et des pages à rappeler les faits opposables aux fantasmes des idolâtres, faits que j’ai déjà en grande partie traités ailleurs et dans mes conférences. Mais je sais aussi qu’il n’est pire sourd que l’idéologue qui ne peut pas entendre et que là où est le vide, il n’y a pas de fond.
Il n’en demeure pas moins que face aux vrais problèmes liés à une planète qui vit sa vie de planète sans se préoccuper de l’humanité, le seul mot d’ordre qui vaille est « Sauvons l’humanité» et «Faisons l‘humanité plus puissante encore». Vrai en français, comme dans toutes les autres langues.
Par Roger-Michel Bory, Robin Sautter, Vincent Wahl, membres du réseau Bible et Création de l’Église protestante unie de France.
(Texte des trois auteurs rapportés sans modifications d’erreurs ou de style). Publié le 04/12/2020 sur https://forumprotestant.fr/articles/bory-sautter-wahl-ecologie-sortir-du-manicheisme/.
Réagissant à l’article d’Yves Roucaute (Le puits sans fond de l’écologie profonde), 3 membres du réseau Bible et Création refusent le «manichéisme fabriqué» entre «l’écologie du progrès et l’écologie profonde» puisque «ce n’est pas être contre le progrès, bien au contraire, que de se poser sans cesse la question du bon usage et de la finalité des outils dont nous disposons». Et proposent 5 points pour «sortir de ce manichéisme».
Il est difficile de réagir à un article où l’auteur manie, avec dextérité, le pamphlet, la stigmatisation et le mépris de tous ceux qui ne partagent pas sa propre idéologie sans tomber soi-même dans le piège d’une spirale de l’insulte! Il serait tout aussi dérisoire de répondre point par point à l’instrumentalisation de données scientifiques au profit d’un postulat «La santé impose le progrès donc les sciences, donc la croissance».
Ce postulat faisant l’éloge de la croissance réduit au rang d’idéologues tous ceux qui la remettent en cause, soit en prenant au sérieux le risque d’effondrement (dans le but de l’éviter!), soit en pronant la décroissance, ce qui est une simplification abusive. En effet, les opposants à la perspective de l’auteur ne se réduisent pas à ces deux catégories. On peut questionner la pertinence des innovations technologiques en termes de progrès sans être systématiquement opposé à la science! C’est même le cas de la plupart des scientifiques eux -mêmes. Enfin les questions sociale et politique sont entièrement absentes du discours de M. Roucaute, sinon pour fustiger les rouges-verts au détour d’un paragraphe. Or, la question de l’accès au progrès a souvent à voir avec des problèmes de revenus, de répartition, d’aménagement du territoire, et la possibilité ou non du contrôle de ce progrès est une des questions majeures de la politique. De même, les positions écologistes sont très nombreuses et diverses, et la dichotomie entre l’écologie du progrès et l’écologie profonde dont parle M. Roucaute, est dénuée de la moindre réalité. Ce manichéisme fabriqué relève, ni plus ni moins, de la bonne vieille rhétorique du bouc émissaire, si utile pour détourner l’attention des vrais problèmes, pour éluder les responsabilités, pour éviter toute remise en cause d’un système dans la perspective d’un réel progrès des idées. La dénonciation d’une idolâtrie relève du même mécanisme de pensée, sans doute évoquée pour émouvoir un public protestant qui y est sensible. A ce stade, soulignons quelques points pour sortir de ce manichéisme.
1. L’effondrement ne signifie pas la fin du monde
C’est Arrhenius, chimiste suédois, qui a mis en évidence l’effet de serre du CO2 dans l’atmosphère à la fin du 19esiècle et qui, il y a près d’un siècle, a évoqué le risque d’effondrement. Cette notion a été reprise par de nombreux auteurs et en particulier par le rapport Meadows, commandé par le club de Rome en 1972, pronant la décroissance. L’effondrement dont il est question n’est pas celui de la planète ni même de l’humanité mais l’effondrement d’une civilisation née en occident, qui s’est imposée de manière impériale et a mêlé le meilleur sur le plan culturel et sociétal et le pire: colonialisme, esclavagisme, oppression des cultures considérées comme primitives. L’histoire de l’humanité montre que d’autres grandes civilisations, impérialistes elles aussi, se sont effondrées et malgré tout la vie se poursuit. On ne connait pas toujours la complexité des mécanismes qui ont abouti à l’effondrement des civilisations mais on sait aujourd’hui quel est le tendon d’Achille de la nôtre. Elle est dépendante de la fuite en avant d’une croissance technologique et industrielle illimitée qui épuise les ressources d’une planète limitée. Et la conséquence est que, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la faiblesse d’une civilisation a un retentissement planétaire tant sur les questions climatiques que sur la biodiversité. Notre civilisation saura-t-elle porter remède à cette faiblesse? Comment y parviendra-t-elle? S’effondrera-t-elle? Nul ne peut le prédire. Mais il est significatif et inquiétant que la prise de conscience de cette impasse conduise à stigmatiser de plus en plus ceux qui soulignent cette réalité et que, pour ne prendre que la question du réchauffement climatique, les mesurettes qui sont prises de manière dispersée sont loin d’être à la hauteur des discours sur la planète qui brûle et de ce qui serait nécessaire, ne serait-ce que pour tenir les engagements pris à la COP21.
2. Les méfaits d’un mauvais anthropocentrisme
Justifier une domination despotique et même parfois tyranique de l’humain sur la planète par le verset 28 du premier chapitre de la Genèse est un contresens terrible au vu de l’ensemble du contenu biblique. L’image suprême du Seigneur, celui qui domine, en tous cas pour les chrétiens, n’est-elle pas celle de Dieu qui s’est fait homme en Jésus-Christ pour se mettre au service de tous, jusqu’à accepter le procès injuste, la souffrance et la mort dans la perspective de la résurrection et d’un monde nouveau où le loup paitra avec l’agneau? Une image bien différente d’un homme qui instrumentalise, tue et détruit au seul profit de sa puissance et non au bénéfice de la vie. L’humanisme dont se réclame notre civilisation est une notion très ambiguë, louable lorsqu’elle appelle à la fraternité, au respect de toutes les cultures et de chaque humain, lorsqu’elle abolit la peine de mort, mais très perverse quand elle oublie son espérance d’universalisme, un idéal qui se dérobe toujours au moment de l’atteindre et qui vacille même dans les pays qui s’en réclament. Elle enferme alors dans un modèle qui hiérarchise, qui légitime la domination des humanistes, au centre, sur ceux qui ne le seraient pas, les bons et les mauvais. Et pourquoi pas ma culture, ma nation, ma ville…, moi-même au centre comme véritable modèle d’humanité? Un véritable humanisme serait de trouver la juste place de l’humain dans une interdépendance avec le reste du vivant et de la planète. C’est le mérite de l’écologie, en tant que démarche scientifique («science des relations des organismes avec le monde environnant, c’est-à-dire, dans un sens plus large, la science des conditions d’existence», Haeckel, 1873), depuis la fin du 19e siècle, d’avoir souligné cette interdépendance au sein d’écosystèmes, de maisons communes, remettant en cause la prééminence d’une espèce, d’un individu, d’un organe qui serait central… Cela ne remet pas en cause l’importance et le rôle particulier de chaque espèce et bien sûr de l’humain avec ses spécificités particulières qui ne lui donnent que plus de responsabilité par rapport à l’ensemble.
3. La santé
Le concept de santé a beaucoup évolué. Au début du 20e siècle, elle se définissait comme «l’aptitude au travail et à la jouissance»: belle adaptation à une société industrielle occidentale fondée sur la production et la consommation! En 1946, l’OMS ne définit plus la santé comme une aptitude ou une absence de maladie mais comme «un état de complet bien-être physique, mental et social» qui «ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d’infirmité» (préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé). Tenant compte des diversités culturelles, l’OMS a rédigé en 1984 un nouveau texte où la santé n’est plus considérée comme un état mais comme une capacité d’adaptation: on parle de santé «dans la mesure où un groupe ou un individu peut, d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie». Aujourd’hui, on prend conscience qu’il ne peut pas y avoir de bonne santé pour l’humain sans qu’il y ait de bonnesanté du vivant qui nous environne; l’exemple du microbiote intestinal, ces bons microbes qui favorisent notre système immunitaire, bien médiatisé ces dernières années en est un bel exemple. Réduire la santé à la dynamique d’une industrie pharmaceutique et des biotechnologies, même si elles ont leur part incontestable et indispensable dans le domaine de la prévention et des soins, est un raccourci très réducteur. D’ailleurs cette industrie pharmaceutique, dans sa version productiviste, n’est pas à l’abri d’erreurs se traduisant par un certain nombre de scandales sanitaires qui malheureusement la discréditent. Enfin, comme nous le rappelions dans l’introduction, le problème de l’accès à la santé a à voir directement avec la répartition des richesses (le coût de l’accès aux soins) et le caractère plus ou moins solidaire (l’existence d’une couverture médicale mutualisée, par exemple) d’une société. Et cela inclut aussi l’accès à l’eau potable, à une nourriture suffisante et équilibrée, à un logement salubre, à un air exempt de pollutions, au niveau de violence physique et psychique, etc.
4. La distinction entre progrès et croissance industrielle
L’auteur conclut son article par cette maxime: «La santé impose le progrès donc les sciences, donc la croissance». Quel raccourci de la part d’un philosophe! Que les connaissances soient un énorme bienfait, nul n’en doute, y compris dans les possibilités de mise au point de technologies nouvelles. Mais encore faut-il ne pas se laisser aliéner par la fuite en avant technologique selon les termes de Jacques Ellul. La technologie n’est pas une fin en soi mais doit rester un outil dans un but réfléchi et choisi: la permaculture par exemple répond bien aux objectifs de la santé. Il n’est pas sûr que de nouvelles techniques d’exploitation de ressources minérales au fond des océans voire dans des astéroïdes pour fabriquer de plus en plus d’armes de plus en plus performantes aillent dans le même sens… Il n’est pas sûr que l’accumulation de déchets induits par une course à la production soit bonne pour la vie… Il n’est même pas sûr que le développement incessant d’outils de communication ne finisse pas par avoir plus d’effets néfastes que de bénéfices et la vie quotidienne nous montre malheureusement qu’ils servent trop souvent à isoler dans des bulles communautaristes autour de fake news plutôt qu’à s’ouvrir à la richesse de la diversité. Ce n’est pas être contre le progrès, bien au contraire, que de se poser sans cesse la question du bon usage et de la finalité des outils dont nous disposons. Ce n’est pas non plus être contre les sciences que de s’interroger sur les orientations que peut leur faire prendre une économie dominée par une logique exclusivement financière.
5. L’idolâtrie
Nous rejoignons par contre tout à fait l’auteur dans sa dénonciation de l’idéologie en la rapprochant plutôt du terme théologique d’idolâtrie ce qui nous parle plus que la rime douteuse soulignée par l’auteur entre idéologie et écologie (l’emballement du logos peut conduire au dérapage de la plume!). Paul dans sa lettre aux Romains définit fort bien l’idolâtrie: «Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur» (Romains 4,25). Notons que la créature peut être comprise comme la nature, gaïa, et certains ne se privent pas d’en faire une idole, mais en tous cas pas Arne Naess qui a introduit le terme d’écologie profonde, ni même le pape François qui prône une écologie intégrale. La créature idolâtrée est bien plus souvent l’homme qui se proclame tout-puissant, qui est certain d’avoir réponse à tout dans sa confiance inébranlable dans la course au progrès technologique. Prenons exemple sur les véritables scientifiques qui s’astreignent à l’humilité de la recherche, mettant en question toutes les hypothèses et se méfiant avant tout des certitudes. Pour les croyants, gardons l’humilité devant Dieu, le créateur, le Dieu d’amour auquel nous croyons et en qui nous mettons notre espérance d’un monde nouveau. Cette foi que nous avons nous engage à y travailler. Il y a alors toute la place pour un progrès de nos intelligences et de notre discernement, pour une croissance humaine qui ne repose pas sur une croissance industrielle et qui soit porteuse de vie.
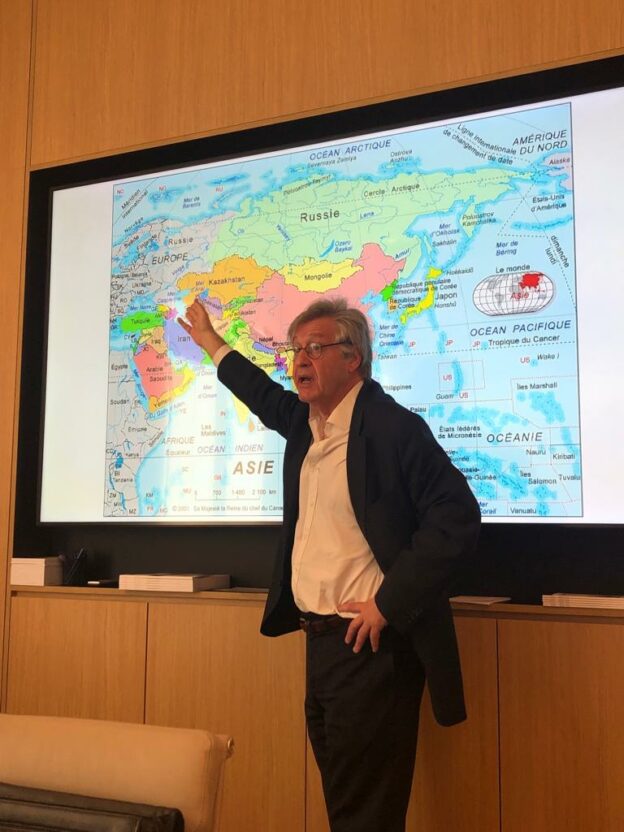








 Il n’est pas anodin que les trois auteurs, à l’image de tous les idolâtres rouges-verts de la planète, m’accusent de « réduire la santé à la dynamique d’une industrie pharmaceutique et des biotechnologies » ce qu’ils dénoncent comme « un raccourci très réducteur ». Et pour vendre leur idéologie, ils inventent que jusqu’au début du 20e siècle, la santé se définissait comme « l’aptitude au travail et à la jouissance » dans une perspective d’adaptation à une société industrielle occidentale fondée sur la production et la consommation. Aujourd’hui, on prendrait « conscience que la bonne santé de l’humain passe par celle du vivant qui nous environne ». Ils donnent l’exemple des bons microbes dont ils ont entendu parler qui favoriseraient notre système immunitaire. Communier avec la nature serait le chemin pour la sauver et nous en même temps.
Il n’est pas anodin que les trois auteurs, à l’image de tous les idolâtres rouges-verts de la planète, m’accusent de « réduire la santé à la dynamique d’une industrie pharmaceutique et des biotechnologies » ce qu’ils dénoncent comme « un raccourci très réducteur ». Et pour vendre leur idéologie, ils inventent que jusqu’au début du 20e siècle, la santé se définissait comme « l’aptitude au travail et à la jouissance » dans une perspective d’adaptation à une société industrielle occidentale fondée sur la production et la consommation. Aujourd’hui, on prendrait « conscience que la bonne santé de l’humain passe par celle du vivant qui nous environne ». Ils donnent l’exemple des bons microbes dont ils ont entendu parler qui favoriseraient notre système immunitaire. Communier avec la nature serait le chemin pour la sauver et nous en même temps.